Rares sont les ouvrages d’histoire du cinéma qui s’attardent sur les aspects économiques, industriels et sociétaux. C’est tout le prix de cette somme sur le cinéma français des années 80, Golden Eighties, parue en fin d’année 2024, sous la plume d’un acteur de l’industrie, le producteur Nicolas Brevière. En près de 800 pages, il revient sur les étapes d’une décennie-clé dans l’évolution du PAF – le paysage audiovisuel français – marqué notamment par l’émergence de Canal Plus et des télévisions privées dans le mode de financement du cinéma. Au-delà de ces aspects, l’ouvrage parvient brillamment à restituer l’esthétique d’une époque, à travers l’analyse de films et scènes emblématiques de la décennie, de Zulawski à Pialat, en passant Carax et Beineix. Une somme précieuse, indispensable et source de multiples plaisirs et (re)découvertes. Rencontre avec son auteur, le producteur Nicolas Brevière

Quelle est la genèse de votre projet ?
Au départ, l’idée était simplement de rencontrer les producteurs de cette époque. J’avais, dès le début, choisi d’organiser ce projet en chapitres annuels. Cela m’a paru naturel, et très vite, je n’ai plus remis en question cette approche. J’ai d’abord fait des recherches exhaustives sur tous les films sortis entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1989. C’était un travail colossal, qui croisait diverses données : les distributeurs, les entrées en France et les budgets des films. En fonction de ces informations, j’ai avancé année par année.
Cet aspect exploratoire vous a-t-il influencé sur la manière de concevoir cet ouvrage-somme ?
Complètement. Ma passion pour la recherche m’a poussé à accumuler autant de matière. Le livre est le résultat de longues années de documentation, mais ce n’est pas un simple recueil d’informations. Ce qui m’intéressait surtout, c’était de structurer ces données et d’y donner du sens. Même si je ne suis ni historien, ni économiste du cinéma, j’ai pris énormément de plaisir à tisser ces éléments pour reconstituer l’histoire de cette décennie, en les feuilletonnant au jour le jour, année après année, chapitre par chapitre.
Quel a été le plus grand défi dans la constitution de cette somme éditoriale ?
Sans doute la collecte et l’organisation des informations ! Ce projet s’est étendu sur plusieurs années et m’a poussé à approfondir de nombreux aspects de l’industrie cinématographique que je ne connaissais pas forcément mais qui conditionnent encore mon métier de producteur aujourd’hui. J’aurais pu m’arrêter à un recueil de portraits de producteurs, mais j’ai souhaité aller au-delà pour comprendre l’ensemble des dynamiques en jeu. Structurer toutes ces informations a été un défi en soi.
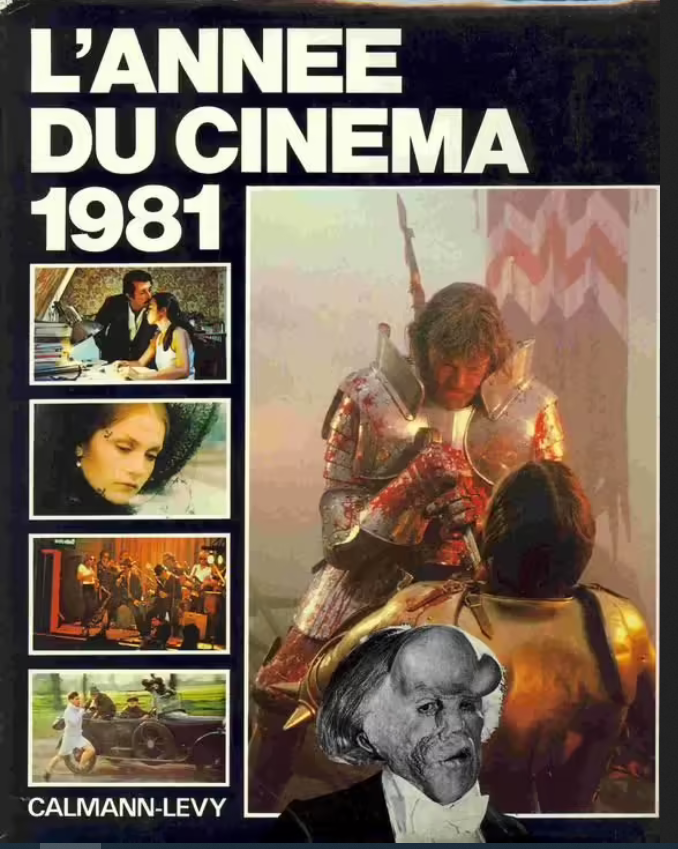
Pourquoi se concentrer sur les films des années 80 ? Était-ce par passion ou aviez-vous un objectif plus précis en tête ?
Un mélange des deux, mais j’avais surtout envie de me plonger dans une recherche approfondie et les années 80 me paraissait une période idéale au regard des bouleversements que l’industrie a connu à ce moment. Quand j’ai commencé, j’étais dans une période de pause, à l’étranger, et j’avais du temps. Cette période m’a permis de plonger dans plusieurs types de sources, notamment une série d’albums annuels sur le cinéma, qui recensaient tous les films année par année, L’Année du cinéma, par Danièle Heymann et Alain Lacombe. Progressivement, cela m’a donné envie de structurer ce travail, sans savoir où cela me mènerait exactement. Finalement, un film comme Possession a vraiment joué comme un déclic.
De quelle manière ?
Comment a-t-il pu voir le jour, en plein contexte de Guerre froide, à Berlin ? La scène d’ouverture au cours de laquelle s’affiche en gros le nom de sa productrice, Marie-Laure Reyre, m’a poussé à en savoir plus sur sa trajectoire et sa collaboration avec Andrzej Żuławski. J’ai trouvé son histoire si captivante que j’ai décidé d’élargir mes recherches et de rencontrer un par un les producteurs emblématiques des années 80. Bien sûr, je n’ai pas pu tous les rencontrer, certains sont restés inaccessibles, comme Claudie Ossard, qui a produit des films iconiques – 37,2 le matin, Arizona Dream, Amélie Poulain ou Equateur, de Gainsbourg – mais dont la légende urbaine dit qu’elle semble s’être complètement retirée du milieu.
Pourquoi ne pas avoir limité votre livre à une série de portraits, un entretien par producteur emblématique pour chaque année ?
Des ouvrages similaires existent déjà, comme celui de Yonnick Flot, basé sur des entretiens, mais je voulais aller plus loin en contextualisant le rôle des producteurs dans leur environnement économique, social, juridique et culturel de l’époque. Les producteurs des années 80 évoluaient dans un contexte en pleine transformation, avec l’arrivée de nouveaux financements comme ceux de Canal Plus, des chaînes privées ou des Sofica. Avant 1984, la vieille garde des producteurs ne disposait pas de toutes les sources de financement modernes et j’ai voulu montrer comment chacun d’eux s’adaptait ou non à ces changements.
Les producteurs que vous avez rencontrés sont-ils toujours en activité ?
Pas tous. Certains comme Maurice Bernart (Thérèse, d’Alain Cavalier) ne sont plus en activité. D’autres, comme Philippe Carcassonne ou Jean-François Lepetit sont toujours en activité. Et d’autres, comme Alain Rocca, ont changé de voie. Albina du Boisrouvray, par exemple, a une histoire personnelle très forte.
Avez-vous choisi les producteurs en fonction de vos goûts personnels ?
Oui, je préférais m’entretenir avec des producteurs comme Jean-François Lepetit, producteur de Trois hommes et un couffin, Yves Gasser, qui avait produit des films comme Loulou, plutôt qu’Alain Terzian, qui produisait des films avec Alain Delon, de manière plus commerciale et adossé à Canal Plus. J’allais aussi vers des producteurs indépendants, comme Martine Marignac, productrice de Passion, de Jean-Luc Godard, d’Otar Iosseliani ou de Jacques Rivette.
Donc, les années 80 correspondent à une forme de professionnalisation accrue du métier ?
Oui, en quelque sorte. Avant l’arrivée de ces nouvelles sources de financement et de ces nouveaux guichets, le producteur prenait davantage de risques financiers, allant jusqu’à hypothéquer ses biens pour financer un film. C’était le cas de producteurs comme Anatole Dauman, Serge Silberman ou le tandem Dancigers-Mnouchkine. Et ce financement restait souvent très opaque… ! Mais dans les années 80, ce risque a été mieux couvert grâce aux soutiens comme Canal Plus et aux subventions, rendant le métier certes moins incertain mais plus structuré et industrialisé.
Ce professionnalisme accru a-t-il changé la manière dont les producteurs travaillaient avec les réalisateurs ?
Oui, il y a eu un changement radical. Jusqu’aux années 80, le producteur jouait un rôle presque tutélaire pour le réalisateur, influençant de près la production et les choix créatifs. Ce rapport a évolué avec l’arrivée de nouvelles lois en 1985, permettant au réalisateur de gagner en autonomie. Progressivement, le producteur est devenu davantage un partenaire qu’un mentor, ce qui a redéfini les relations de travail.
Cette évolution de la production a-t-elle eu un impact important sur la création cinématographique elle-même ?
Le paysage du cinéma des années 80 a changé avec l’essor des télévisions privées et de Canal Plus. Les films ont donc commencé à être « formatés » pour répondre aux attentes de ces nouveaux partenaires financiers, ce qui en a modifié l’esthétique et la portée. Mais mon approche dans le livre n’est ni nostalgique ni critique : je voulais explorer comment cette transformation a influencé les producteurs, les réalisateurs et l’industrie dans son ensemble.

Parmi les nombreux producteurs que vous avez rencontrés, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?
L’histoire d’Albina du Boisrouvray m’a particulièrement touché. Elle a produit des films ambitieux, comme L’Important c’est d’aimer ou Fort Saganne, mais a tout quitté après la mort de son fils pour se consacrer à l’humanitaire. Son parcours est fascinant, tout comme celui de Martine Marignac, qui a soutenu des films d’auteur sans concession – Iosseliani, Carax, Rivette – malgré les difficultés financières. Ces destins, flamboyants et jusqu’au-boutistes – constituent pour moi des exemples. Même chose avec Anatole Dauman, producteur d’Oshima et Wenders, pour lequel j’ai été stagiaire : à chacun de mes rendez-vous avec lui, je ne comprenais pas toujours de quoi il parlait ; mais tout d’un coup, il avait des fulgurances.
En tant que producteur, quel regard portez-vous sur l’évolution du métier depuis cette époque ?
Aujourd’hui, le métier a gagné en technicité, mais il a aussi perdu une part d’artisanat. Dans les années 80, les producteurs prenaient plus de risques personnels pour financer des projets. Aujourd’hui, avec la multiplication des financements publics et privés, la dimension entrepreneuriale est différente. On est davantage encadrés, mais cela enlève parfois un peu de spontanéité. Certains films des années 80 ne pourraient plus voir le jour aujourd’hui en raison des critères de rentabilité actuels.
Votre ouvrage ne se consacre pas seulement à la production, mais relate aussi l’histoire économique et industrielle d’une décennie. Sur quel types de sources vous êtes-vous appuyé pour documenter ce contexte ?
J’ai travaillé principalement à partir des rapports du CNC, qui dressaient chaque année un bilan des agréments, des entrées, du profil du public, des parts de marché, etc. Ces archives m’ont permis de mieux comprendre l’évolution du marché. Pour feuilletonner au jour le jour l’évolution du paysage industriel cinématographique des années 80, je me suis basé sur les archives du Film français. En plus, les archives de certaines revues de cinéma, comme Les Cahiers du Cinéma, Positif, La Revue du cinéma ou Cinématographe, m’ont également été précieuses. Elles reflétaient bien l’état d’esprit du cinéma d’auteur en France, souvent en contraste avec la machine hollywoodienne.

Votre livre n’est pas seulement composé d’éléments industriels et économiques. Il contient aussi un mélange d’analyses et de témoignages personnels.
Exactement ! Il m’importait d’intégrer d’insuffler quelque chose de personnel dans la description pure et dure de l’économie et du juridique. Et c’est pourquoi j’ai inclus des focus spécifiques, rassemblés année après année au sein d’une même rubrique, (Re)voir, consacrés à des films en particulier – Once more, de Paul Vecchialli, ou Hôtel des Amériques, d’André Téchiné, considéré aujourd’hui comme un de ses plus beaux films, mais mésestimé en son temps – ou à des sujets du moment, comme les femmes réalisatrices des années 80, très peu nombreuses à avoir réalisé un deuxième film.
Même chose pour la rubrique Dernière image, dans laquelle je m’attarde sur des films des années 80 qui me plaisaient et leur dernier plan, souvent un sublime regard : Michel Blanc dans Tenue de soirée, Isabelle Adjani dans Possession, Gaspard Manesse dans Au revoir les enfants.
D’où vient alors le titre Golden Eighties ? Il semble évoquer un âge d’or, mais cette décennie est marquée par une série de crises et de bouleversements incessants.
Le titre vient de mon éditeur, qui voulait marquer cette période de manière positive. Personnellement, j’avais envisagé un titre plus neutre, moins nostalgique, pour mieux refléter les ruptures et les défis auxquels le secteur a fait face dans ces années-là. Le terme Golden Eighties est un clin d’œil, notamment à Chantal Akerman, mais mon intention était surtout d’examiner en détail les transformations structurelles de cette époque. Même si le cinéma est en crise permanente depuis 1895 !
Combien de temps ce projet vous a-t-il accaparé ?
J’ai commencé en 2015 et il m’a fallu près de sept ans pour le mener à bien, entre la recherche et l’écriture. Et mes activités de producteur ! La période du Covid m’a été propice pour bien avancer côté écriture. Ce fut un travail de longue haleine, mais le plaisir de chercher et d’assembler les pièces du puzzle m’a porté tout au long de cette aventure.
Votre projet est fascinant par son ampleur, car il mêle recherches historiques, économiques, sociologiques, avec des analyses cinématographiques et anecdotes personnelles. Aviez-vous un modèle ?
Pas vraiment un modèle, mais une sorte de boussole : La Vingt-cinquième image, de René Bonnell. Un ouvrage macro-économique très pointu qui brosse un panorama très exhaustif des différentes composantes de l’industrie du cinéma sur le champ de la production, de la distribution et de l’exploitation.
Quels sont les principaux aspects que vous cherchiez à mettre en lumière ?
L’autre aspect qui m’a frappé au regard de l’époque actuelle c’est le poids du politique. Jack Lang a imprégné de son empreinte ces années. La politique ne nous a certes pas forcément permis de progresser – on a toujours été en retard, que ce soit sur la question de la vidéo ou de la TV privée – mais de nous protéger et de nous défendre. A ce titre, la mesure la plus emblématique de cet état d’esprit, c’est la décision prise en 1982 de bloquer à Poitiers les importations de magnétoscopes japonais ! Comme si on pouvait aujourd’hui bloquer les iphone à Poitiers, par exemple.


Dans votre ouvrage, vous évoquez également la bataille critique entre les défenseurs d’Une chambre en ville et ceux de L’As des as, tous deux sortis le même jour. En quoi cet événement – et les années 80 – constituent-ils un tournant pour le travail de la critique ?
En fait, il n’y avait pas de critiques qui défendaient L’As des as ! La polémique s’est davantage polarisée sur l’inégalité de traitement en termes de salles entre deux films, l’un « populaire » et l’autre « d’auteur ». Ce qui m’a interpellé était cet encart dans la presse signé par l’ensemble de la critique cinéma de l’époque (et que je cite dans son intégralité) : « Mercredi 27 Octobre 1982, jour de grève de la RATP, 71.000 Parisiens sont allés voir L’As des as de Gérard Oury, contre 3.165 qui ont choisi Une chambre en ville de Jacques Demy. Deux films, deux chiffres. Deux poids, deux mesures. Tout est affaire de surface. L’écrasement informatif et publicitaire des films préconçus pour le succès est tel que même un cinéaste de l’importance de Jacques Demy risque de voir son public potentiel détourné. Pourtant, Une chambre en ville est un grand film populaire qui, dans le cinéma français d’aujourd’hui, fait figure d’œuvre unique. Une fois n’est pas coutume, nous, critiques de cinéma dans les principaux organes de presse, toutes tendances confondues, faisons appel à nos lecteurs-spectateurs. Si la critique, de plus en plus notée par le flot promotionnel, a encore une raison d’exister, voilà bien l’occasion de le prouver. Cela explique que nous, qui l’avons passionnément aimé, éprouvons la nécessité de mêler nos voix pour la défense d’un grand film. Comme nous l’aurions fait hier pour La Règle du jeu ou Lola Montès. Aussi invitons-nous, une fois encore, nos lecteurs à ne pas manquer ce rendez-vous essentiel. Car, aujourd’hui, l’échec de Une chambre en ville serait aussi celui du cinéma français. Ni plus, ni moins. ». Pourrait-on imaginer aujourd’hui une telle tribune aussi virulente, réunissant l’ensemble de la critique française, alors qu’il sort en moyenne une quinzaine de films par semaine et de tout calibre ? Je crois que cette tribune a acté ce qu’on a appelé « le divorce entre la critique et le public », en ce sens qu’on s’est rendu compte qu’il n’était pas possible pour la critique de forcer le public à voir un film dont il ne voulait pas. J’ai l’impression aussi que la période des années 80 a été un tournant : les grands maîtres (Hitchcock, Bergman, Rossellini, Visconti, Bresson etc.) disparus, il a fallu que la critique se réinvente. Une nouvelle génération de critiques est née – portée notamment aux Cahiers du cinéma -, mais la frontière entre le « travail critique » tel qu’on le connaissait et le commentaire sur « l’actualité du cinéma » dont se sont emparés de nombreux supports de presse a un peu dilué justement le travail DU critique de cinéma.
Quel regard portez-vous sur la critique aujourd’hui, telle qu’elle s’exprime dans la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux ?
J’ai l’impression qu’aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut être critique de cinéma ! Il suffit de « scroller » et parfois on n’hésite plus à démolir la critique d’un film davantage que le film lui-même, brouillant encore un peu plus les frontières. Sur quelle autorité dois-je m’appuyer pour aller voir un film ? Je trouve que le travail du critique aujourd’hui est de plus en plus héroïque : il y a beaucoup de films qui sortent et il n’y a pas toujours la place d’en parler dans les supports « phares » que sont par exemple aujourd’hui Les Cahiers, Positif, Libération, Le Monde ou les Inrocks par exemple. Ou alors il faut chercher dans des blogs ou des éditions numériques comme Revus et Corrigés qui sont moins liés à l’actualité. Et puis apparaissent des espaces « critiques » qui peuvent totalement nous échapper comme « Letterbox » par exemple où ce sont plutôt des jeunes qui par un système d’étoiles et de points parviennent à se constituer des petites communautés pour commenter les films à voir et convaincre leurs followers, créant leur propre cinéphilie sans influence de la critique.
En quoi les articles de critique cinéma ont-ils contribué à la rédaction de votre ouvrage ?
La critique de cinéma a été au cœur de mes recherches lorsque j’ai entrepris cet ouvrage. Il ne s’agissait pas simplement de parler de la mutation d’une industrie, mais également quels films on faisait à l’époque et comment ils étaient perçus. Je me suis plongé principalement dans 4 espaces critiques : Les Cahiers du cinéma, Positif, Cinématographe et Cinéma (mais aussi La Revue du Cinéma, l’Avant-scène cinéma, Première etc.). Cela m’a été indispensable pour ressentir la pulsation d’une époque : ce qu’on aimait, ce qu’on détestait, ce qui marchait, ce qui échouait. Je pense que cet ouvrage aurait eu sans doute moins d’intérêt s’il ne se concentrait uniquement à l’industrie. Dans cet ouvrage il y a notamment un chapitre intitulé (Re)voir dans lequel je reviens sur quelques films emblématiques de cette époque et leur réception par la critique. J’ai été très étonné par les critiques assez unanimement mauvaises de Hôtel des Amériques (Techiné, 81), L’Homme blessé (Chéreau, 83), Sous le soleil de Satan (Pialat, 87) et même Golden Eighties (Akerman, 86) alors qu’aujourd’hui, ces films ont une cote critique très forte; à l’inverse, j’ai été surpris par exemple de l’indulgence de la critique pour Les Ripoux (Zidi, 84). En tout cas, me replonger dans la critique de l’époque a été un bain extrêmement vivifiant mais je pense qu’un ouvrage sur la critique reste à faire !!
En dehors des événements déjà évoqués, y en a-t-il un qui vous ait marqué en particulier ?
Il y en a tellement ! Mais en consultant ces archives, cela m’a permis de redécouvrir l’histoire de Canal plus au jour le jour, et me rendre compte qu’il s’agissait d’une idée assez ancienne, issue du seul bon plaisir de François Mitterrand, créée sans aucun débat. J’ai pu également me replonger dans les arcanes et les détails de la privatisation de TF1, notamment les auditions – télévisées ! – des repreneurs, Bouygues et Hachette. Aujourd’hui, l’intérêt pour ces questions n’est plus de même intensité.
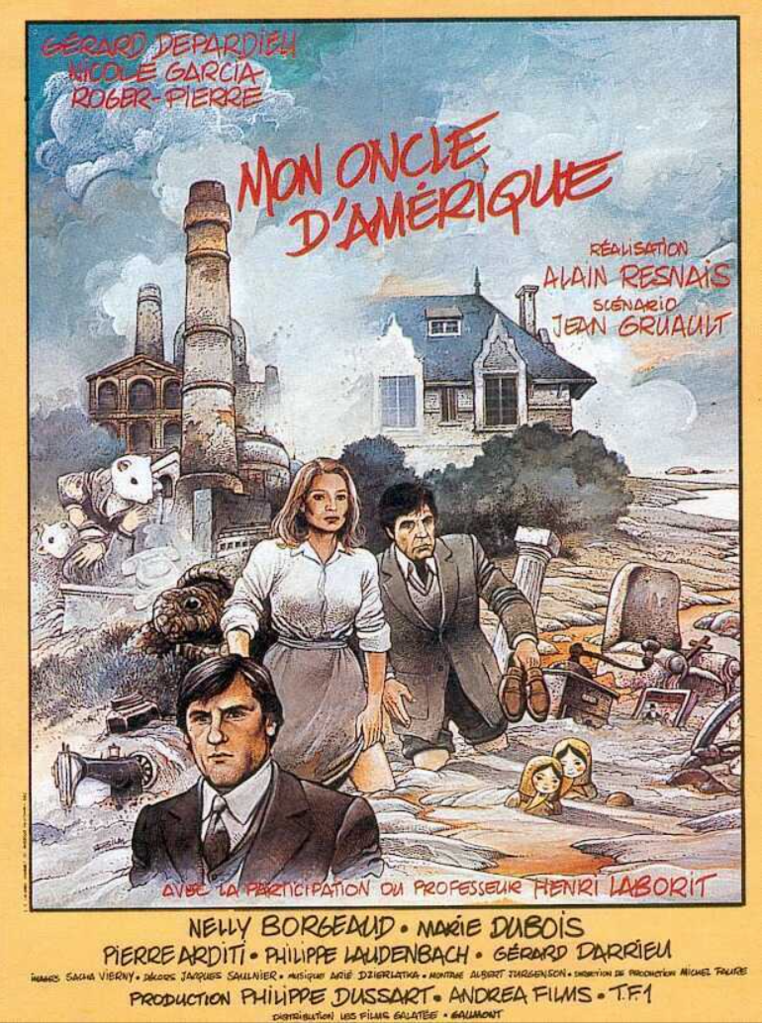
Et parmi tous les films des années 80, y en a-t-il un en particulier qui vous tient à cœur ?
En revisitant cette décennie, quatre films se sont démarqués : Mon oncle d’Amérique d’Alain Resnais, Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard, Loulou de Maurice Pialat, et Le Dernier Métro de François Truffaut. Ces œuvres, sorties la même année (1980) à quelques semaines d’intervalles, sont pour moi emblématiques des années 80 et ont contribué à façonner mon amour du cinéma. Quatre énormes succès, et peut-être le meilleur film de leurs auteurs. À la fin de la décennie ça a été Trop belle pour toi, de Bertrand Blier, Peaux de vache de Patricia Mazuy, Une affaire de femmes de Claude Chabrol et Les Amants du Pont-Neuf, de Léos Carax.

Si vous aviez l’occasion de vous consacrer à une autre époque ou à un autre aspect de l’industrie, laquelle choisiriez-vous ?
Sans doute les années 70 ! Cette décennie a marqué une transition importante dans le cinéma français, avec des figures de producteurs comme Jean-Pierre Rassam et la prise en main de Gaumont par Nicolas Seydoux et Toscan du Plantier. Cette période de sortie de la Nouvelle Vague et les bouleversements qui l’ont suivie m’intéressent particulièrement. Sinon, je me pencherai peut-être sur un réalisateur ou une réalisatrice, mais il est peu probable que je revienne au sujet des producteurs, du moins pas dans le même format.
Un dernier mot pour conclure : si vous deviez choisir une phrase, une idée pour résumer votre livre-somme et l’expérience qu’il représente, ce serait quoi ?
Ce livre est le fruit d’un long voyage dans une époque riche et complexe. C’est moins un projet nostalgique qu’un regard sur une période de transition. J’ai voulu, au fil des pages, montrer comment les choix économiques, les innovations juridiques, politiques et technologiques (le choc de la cassette vidéo, l’irruption de Canal Plus, le financement par les chaînes privées, la mise en place progressive de la chronologie des médias…) et les aspirations artistiques ont façonné le cinéma français des années 80. Plus qu’un témoignage personnel, c’est une invitation à replonger dans cette décennie et à en redécouvrir les enjeux et leurs acteurs. Et constater combien ils structurent encore aujourd’hui notre mode de production en France.
Propos recueillis par Sylvain Lefort
Golden Eighties, La Guerre entre Louis de Funès et Marguerite Duras n’aura pas lieu, Nicolas Brevière, éditions Carlotta, Préface de Nathalie Coste Cerdan – 760 pages
Pour se procurer le livre sur le site de Carlotta : https://laboutique.carlottafilms.com/products/golden-eighties-livre?srsltid=AfmBOorS7Xk95o5D5u0gDWxZ3z1US4qvSQLZ_NRazPXZDAkF50e13Tvb
Catégories :ENTRETIENS









































































































































